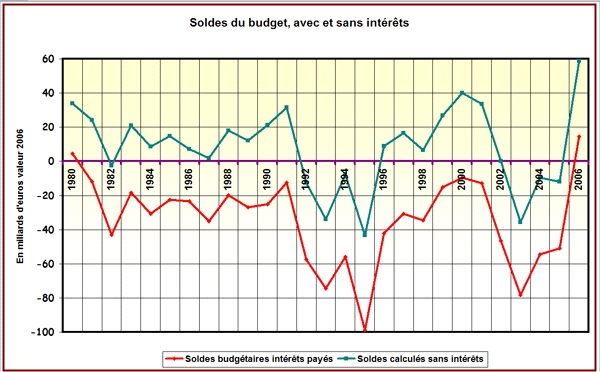(1’20’’) Ali Badou : On voyait la réaction de la banque américaine : baisser rapidement les taux, et le refus de Jean-Claude Trichet, président de la banque centrale européenne, de baisser les taux d’intérêts (pas d’inflation, pas de baisse de taux) ; est-ce que ces deux attitudes sont vraiment contradictoire ?
Daniel Cohen : oui, totalement, totalement contradictoire, on a d’un côté une banque centrale américaine qui fait de la lutte contre la récession (annoncée et à venir) la priorité, au risque de relancer l’inflation en 2008 et d’écorner sa crédibilité (surtout si l’inflation apparaît en même temps que la récession), et, en face, une BCE qui fait le pari exactement inverse, c’est-à-dire d’ignorer le risque de récession (à l’image de la Fed qui ignore de risque d’inflation) et ne se préoccupe (là encore en image inversée de la Fed) que de l’inflation : deux positions radicalement opposées et, je trouve, aussi extrêmes l’une que l’autre. (…)
Ces politiques sont le résultat d’une histoire : dans le cas de la Fed, la crise de 29 continue d’habiter les esprits : Ben Bernanke lui-même est un ancien professeur d’économie dont la thèse portait sur la crise de 1929 et dont la thèse était que — à l’image de ce que disait déjà Milton Friedman—, la Fed, à l’époque, a porté une grande part de responsabilité dans la crise de 1929 parce qu’elle avait sous-estimé le risque de cette crise et laissé entrer en crise les banques américaines (près de 50 000 banques avaient fait faillite en l’espace d’un an et la Fed avait laissé, impavide, ces banques aller à la faillite), donc ça, c’est une erreur que la Fed ne veut pas reproduire, en tout cas que Ben Bernanke ne veut pas reproduire (…)
(1’25’’10) Donc, on a des banques qui perdent parfois 30-40% de leur valeur, ça veut dire, tout d’un coup, leur capital qui se réduit comme peau de chagrin ; du coup, des difficultés qu’elles trouveront à se refinancer aussi ; bref, tout un mécanisme qui est dangereux chez nous aussi et vis-à-vis desquels la seule solution est une baisse des taux : quand une banque est en difficulté (prenez City Bank, elle a perdu 60% de sa valeur en l’espace de six mois)… comment aider une banque qui fait faillite à se redresser ?
Il n’y a que deux solutions : soit vous avez des capitaux frais qui la refinancent, et ça c’est ce que les banques US essaient de faire en faisant appel à Singapour, à Abou Dabi, à des fonds souverains qui viennent les refinancer ; soit, au fond, l’État met de l’argent au pot, or (et c’est d’ailleurs une des causes de la crise de cette semaine : on attendait un plan Bush destiné à refinancer les banques et) ça a été un plan en généralité destiné en réalité à préparer la réélection d’un républicain en donnant des baisses d’impôts un petit peu à tout le monde, bref quelque chose qui coûte beaucoup d’argent mais qui est complètement à côté de la plaque.
Donc, si l’État ne vient pas soi-même au service de la recapitalisation des banques d’un côté, et si les grands fonds veulent bien mettre de l’argent mais pas au point de resolvabiliser, qu’est-ce qui reste comme solution ? Et bien il n’y en a pas beaucoup, parce que [bgcolor=#FFFF99]mettre des liquidités dans le système comme font les banques centrales depuis l’été, ça ne resolvabilise pas quelqu’un qui est en défaut[/bgcolor] : « vous n’avez pas d’argent, je peux vous en prêter mais si je vous demande de rempbourser… »
Ali badou : … oui, mais ça le sauve alors qu’il serait en faillite autrement…
Daniel Cohen : oui mais ça le sauve temporairement : faire une avance de crédit à une banque en difficulté ne sort pas cette banque de la difficulté.
Alors cette situation, ça n’est plus la crise de 1929 qui devient la bonne référence, mais c’est plutôt la crise japonaise des années 1990 : les banques japonaises ont été brutalement plombées par le retournement du cycle hypothécaire, déjà, il y a eu une bulle immobilière extravagante dans les années 80 au Japon (…) qui s’est retournée comme prévu en réalité, et du coup, les banques se sont retrouvées avec un portefeuille complètement insolvable de crédits hypotécaires, et elles ont mis dix ans, chaque année en mettant un peu de profit de côté à reconstituer leur capital.
Donc, on peut être dans une situation qui peut être dure et durable si les banques sont amputées des réserves qui leur permettraient de faire des crédits sans aucune solution de sauvetage. (…) et dans une situation comme celle-là, il n’y a que des taux d’intérêts très faibles pendant longtemps qui peuvent sauver les banques, parce qu’avec des taux faibles, elles peuvent, ; progressivement, reconstituer des marges en se finançant bon marché et en faisant des crédits un petit peu plus onéreux, mais ça, c’est la voie que l’Europe, pour l’instant, a fermée. (…)
(1’34’’32) Ali Badou ; Georges Soros disait qu’on sortait d’un cycle de 60 ans de création monétaire et d’endettement et que c’était la fin du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Vous partagez ce point de vue ?
Daniel Cohen : non, la référence à un cycle de 60 ans ne me paraît pas la bonne ; on vit certainement la fin d’un cycle commencé par Greenspan quand il a pris ses fonctions en 1987, donc c’est un cycle plus court, de 20 ans : les USA avaient glissé vers l’inflation dans les années 60 et 70 ; avec la politique de Paul Volker, un immense coup d’arrêt à cette dérive inflationniste avait été fait et avait été très coûteuse, c’est une des récessions les plus sévères d’après guerre que les USA avaient connu en 1982, la deuxième année du mandat de Raegan à l’époque, et l’inflation avait été éradiquée d’une certaine façon définitivement, et c’est ce qui avait permis à Alan Greenspan de surfer sur la vague de croissance due au boom des nouvelles technologies, sans se préoccuper de l’inflation (le souci de Greenspan était simplement d’éviter la récession). On a d’ailleurs eu à cette époque l’illusion qu’une croissance permanente était possible. (…)
(1’45’’45) On a l’impression qu’il n’y a plus de communication entre la BCE et les différents Conseils des Ministres, c’est tragique : c’est tragique qu’il n’y ait pas un consensus, une discussion, entre pairs qui font un diagnostic, qui peuvent diverger par moments mais qui visent un même but. Alors là, justement, c’est le but qui n’est pas le même, alors c’est une cacophonie. (…)
(1’46’’50) Une bonne politique, quand on a à la fois un risque d’une monnaie surévaluée et un risque inflationniste, une bonne politique, en tout cas dans les livres, ce qu’on enseigne à nos élèves, c’est à la fois d’avoir une politique monétaire laxiste pour empêcher que la monnaie se surévalue et que les taux d’intérêt ne restent à des niveaux trop élévés, et une politique budgétaire restrictive. Le bon policy mix face à une situation comme celle-là, ça n’est pas d’appuyer sur tous les boutons à la fois. (…)
(1’47’’40) Ce débat sur le policy mix, en Europe, il n’a jamais eu lieu. Chacun veut prendre le domaine de compétence de l’autre : la BCE dit : « faites une politique budgétaire rigoureuse parce que c’est la seule façon de crédibiliser l’euro », et les ministres des finances disent à la politique monétaire : « soyez laxiste », donc chacun essaie d’empiéter sur le territoire de l’autre et il n’y a pas de coordination possible. (…) Mais comme la politique budgétaire consolidée n’existe évidemment pas, et qu’on empile des politiques hétérogènes, la BCE ne considère pas qu’elle a un interlocuteur capable de délivrer, comme on dit en anglais, une politique budgétaire adaptée à une stratégie. C’est ce déséquilibre institutionnel-là qu’on retrouve à l’œuvre dans cette cacophonie, en effet, de l’Eurogroupe d’un côté, et de la BCE de l’autre.
(1’49’’35) Alain-Gérard Slama : je voudrais vous renvoyer du problème des institutions au problème des acteurs : on nous disait toujours que le capitalisme s’autorégulait, et en particulier les banques, alors comment se fait-il qu’elles aient été à ce point prises à défaut ?
Daniel Cohen : [bgcolor=#FFFF99]tous ceux qui ont pu penser que le système financier pouvait s’auto-réguler sont des naïfs ou des incompétents. [ou des voleurs… ÉC] C’est la seule chose dont on peut être sûr : c’est que le système financier, dans toute son histoire éternelle, va de crise financière en crise financière. L’idée qu’on puisse demander aux acteurs d’arrêter de prendre des risques lorsque tout le monde connaît la pathologie du système, qui est que dans tout système financier normalement constitué, lorsqu’il y a des gains, c’est pour les opérateurs qui les ont générés, et lorsqu’il y a des pertes, elles sont toujours mutualisées, soit parce que c’était les déposants (c’était le cas jusqu’en 1929), soit parce que c’est les États qui viennent au secours des pertes…[/bgcolor]
Donc, à partir du moment où on a un jeu assymétrique — et encore une fois, c’est toujours le jeu des marchés financiers —, il est sûr que les marchés financiers vont toujours à la limite, à la limite du risque parce que celui — raisonnons en terme de stocks options, c’est un très bon exemple — « je gagne si ça monte, mais si ça baisse je ne perd pas », puisque ma rémunération est indexée à la hausse, le système financier fonctionne suivant ce principe : si ça marche, vous faites un bon deal, bravo, formidable bonus, et si ça marche pas, si vous faites perdre des milliards, bon ben vous perdez votre job, vous allez en trouver un autre, mais vos pertes ne sont pas proportionnées aux pertes que vous faites subir à la société.
Donc, tout système financier est forcément instable pour cette raison même, on le sait, et l’enjeu est donc 1) d’avoir des régulations qui permettent, autant que faire se peut de limiter les excès (les régulations sont toujours détournées au bout du compte, il n’y a aucune régulation qui ne vaut très longtemps ; ça ne veut pas dire qu’il n’en faut pas) ; 2) et surtout, il faut protéger la société de ces excès. C’est ce qu’on a fait après 1929, on a compris qu’il fallait protéger les déposants des risques que les banques leur faisait courir : et on a un système de garantie de dépôts aux Etats-Unis qui fait qu’on n’a plus de crise systémique ; on a des crises bancaires, mais on n’a plus de crise de système comme il y a eu après 1929.
Donc, c’est cette réflexion qu’il faut toujours avoir, mais [bgcolor=#FFFF99]l’idée que les marchés financiers pourraient trouver eux-mêmes la voie de la raison est une méconnaissance complète des mécanismes.[/bgcolor]
Alors juste pour conclure sur ce point parce que c’est important, dans [b]la régulation de Bâle[/b], c’est-à-dire dans [color=red][b]la régulation que les banques s’imposent à elles-mêmes, on est arrivé en effet, et c’est sans doute de l’idéologie qui a été à l’œuvre, au point où on a demandé aux banques d’évaluer elles-mêmes leur coefficient de risque pour fixer les niveaux de réserves prudentielles !
Alors ça, c’est le comble de la déréglementation : quand on voit qu’aujourd’hui [bgcolor=#FFFF99]les banques sont totalement incapables d’évaluer les risques qu’elles ont pris, qu’elles ont fait prendre [/bgcolor]à leurs actionnaires, avec ces produits mathématiques que personne ne comprend, et sans doute pas même ceux qui les ont inventés, [bgcolor=#FFFF99]c’est extravagant de se dire qu’au cœur du logiciel bancaire, il y a une auto évaluation des risques que les banques prennent.[/bgcolor][/b][/color]
Là, il y a certainement un immense retrour de bâton qui va se produire avc la crise des subprimes, et il faut évidemment revenir sur ces dispositions qu’on appelle de « Bâle 2 », il faut être capable de dire : « si moi, régulateur, je ne comprends pas cette formule, alors j’assume le pire, comme on dit en anglais, je suppose que c’est le plus risqué possible, et ne venez pas me dire comme ça a été le cas à propos des subprimes, qu’en fabricant des cocktails de crédits à des ménages insolvables, on arrive à fabriquer des crédits de la plus haute qualité », hein, je rappelle que les subprimes, c’est à l’origine des crédits fait à des délinquants américains, mais qui, combinés par des formules mathématiques, devenaient des crédits de qualité égale à la dette des gouvernements, ce qu’on appelle des crédits triple A ! C’est extravagant de penser qu’on arrive à fabriquer les uns à partir des autres, c’est pourtant ce qui s’est passé. Là, la régulation doit passer pour empêcher ça.
Olivier Duhamel : mais alors, comment, en attendant, sortir du dilemme diabolique d’aujourd’hui si on est responsable politique et encore plus si on est responsable des grandes banques centrales, première ligne Etats-Unis ? Si je ne fais rien, je laisse arriver une récession catastrophique ; si j’interviens, je viens payer à la place des gangsters…
Daniel Cohen [qui n’envisage pas une seconde, curieusement, qu’on retire définitivement aux banques privées le droit de création monétaire, alors que ce serait, à l’évidence, la seule bonne solution durable aux crises du capitalisme. ÉC] : il n’y a pas de solution. Il faut toujours naviguer entre ces deux maux. Sauver les banques aujourd’hui serait la bonne solution : injecter les 100 milliards (si les 100 milliards promis par Bush avaient été injectés dans les banques, il n’y aurait plus de crise), mais évidemment, en faisant cela, je récompense les gangsters, évidemment ce n’est pas possible.
Alors, il faut trouver, il faut ruser, il n’y a pas de solution simple, et les crises financière font partie, encore une fois, du monde dans lesquel on vit, et il faut sans cesse ruser sans cesse avec ça. Je pense qu’on aurait pu couper la poire en deux, je ne veux pas être aristotélicien, chaque fois sur les questions que vous me posez, c’est-à-dire prévoir un fonds de sauvetage pour les banques les plus en difficulté, mettre de côté 50 milliards pour rassurer (…), et puis criminaliser les dirigeants (comme on l’a fait à la suite de l’affaire Enron), dire « il y a des sanctions, y compris pénales, de responsabilité des dirigeants » face à des maux de cette nature parce qu’ils ont mis en péril la communauté. »
 )
)